La diplomatie migratoire franco-algérienne oscille entre tentatives de restriction et ajustements pragmatiques. Les mesures coercitives, comme la restriction des visas ou la menace de dénoncer l’Accord de 1968, se révèlent inefficaces et sont davantage des outils de communication politique que des instruments réellement opérationnels. L’histoire démontre que les régulations restrictives n’ont jamais véritablement endigué les flux migratoires, mais ont plutôt contribué à les rendre plus complexes et informels. L’impasse actuelle pourrait déboucher sur une nouvelle révision de l’Accord de 1968, mais avec peu de marges de manœuvre tant les intérêts des deux pays divergent. Pour l’Algérie, cet accord est un levier de souveraineté et un acquis politique. Pour la France, il est devenu un enjeu politisé, souvent instrumentalisé pour des raisons électorales mais dont la remise en cause serait juridiquement et diplomatiquement délicate. En somme, la restriction des migrations entre la France et l’Algérie s’avère inefficace et crée plus de tensions qu’elle n’en résout. L’histoire des politiques migratoires entre les deux pays illustre bien que la gestion des migrations par la fermeture est une illusion politique plutôt qu’une solution efficace.
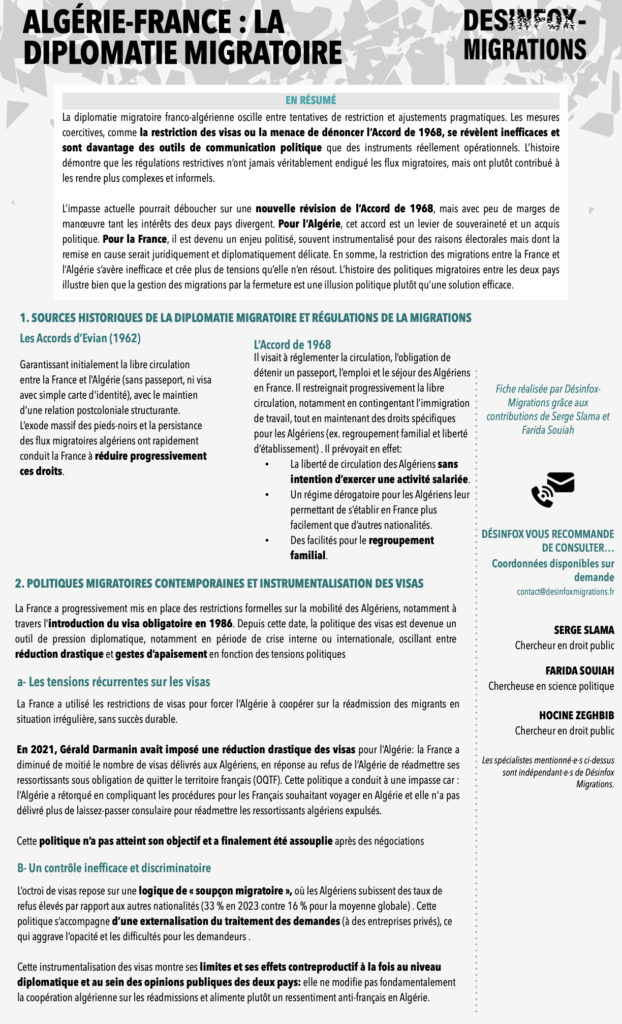
1. SOURCES DE LA DIPLOMATIE MIGRATOIRE ET RÉGULATIONS DE LA MIGRATIONS
Les Accords d’Evian (1962)
Garantissant initialement la libre circulation entre la France et l’Algérie (sans passeport, ni visa avec simple carte d’identité), avec le maintien d’une relation postcoloniale structurante. L’exode massif des pieds-noirs et la persistance des flux migratoires algériens ont rapidement conduit la France à réduire progressivement ces droits.
L’Accord de 1968
Il visait à réglementer la circulation, l’obligation de détenir un passeport, l’emploi et le séjour des Algériens en France. Il restreignait progressivement la libre circulation, notamment en contingentant l’immigration de travail, tout en maintenant des droits spécifiques pour les Algériens (ex. regroupement familial et liberté d’établissement). Il prévoyait en effet:
- La liberté de circulation des Algériens sans intention d’exercer une activité salariée.
- Un régime dérogatoire pour les Algériens leur permettant de s’établir en France plus facilement que d’autres nationalités.
- Des facilités pour le regroupement familial.
2. POLITIQUES MIGRATOIRES CONTEMPORAINES ET INSTRUMENTALISATION DES VISAS
La France a progressivement mis en place des restrictions formelles sur la mobilité des Algériens, notamment à travers l’introduction du visa obligatoire en 1986. Depuis cette date, la politique des visas est devenue un outil de pression diplomatique, notamment en période de crise interne ou internationale, oscillant entre réduction drastique et gestes d’apaisement en fonction des tensions politiques.
a- Les tensions récurrentes sur les visas
La France a utilisé les restrictions de visas pour forcer l’Algérie à coopérer sur la réadmission des migrants en situation irrégulière, sans succès durable.
En 2021, Gérald Darmanin avait imposé une réduction drastique des visas pour l’Algérie: la France a diminué de moitié le nombre de visas délivrés aux Algériens, en réponse au refus de l’Algérie de réadmettre ses ressortissants sous obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cette politique a conduit à une impasse car : l’Algérie a rétorqué en compliquant les procédures pour les Français souhaitant voyager en Algérie et elle n’a pas délivré plus de laissez-passer consulaire pour réadmettre les ressortissants algériens expulsés.
Cette politique n’a pas atteint son objectif et a finalement été assouplie après des négociations
B- Un contrôle inefficace et discriminatoire
L’octroi de visas repose sur une logique de « soupçon migratoire », où les Algériens subissent des taux de refus élevés par rapport aux autres nationalités (33 % en 2023 contre 16 % pour la moyenne globale) . Cette politique s’accompagne d’une externalisation du traitement des demandes (à des entreprises privés), ce qui aggrave l’opacité et les difficultés pour les demandeurs.
Cette instrumentalisation des visas montre ses limites et ses effets contreproductif à la fois au niveau diplomatique et au sein des opinions publiques des deux pays: elle ne modifie pas fondamentalement la coopération algérienne sur les réadmissions et alimente plutôt un ressentiment anti-français en Algérie.
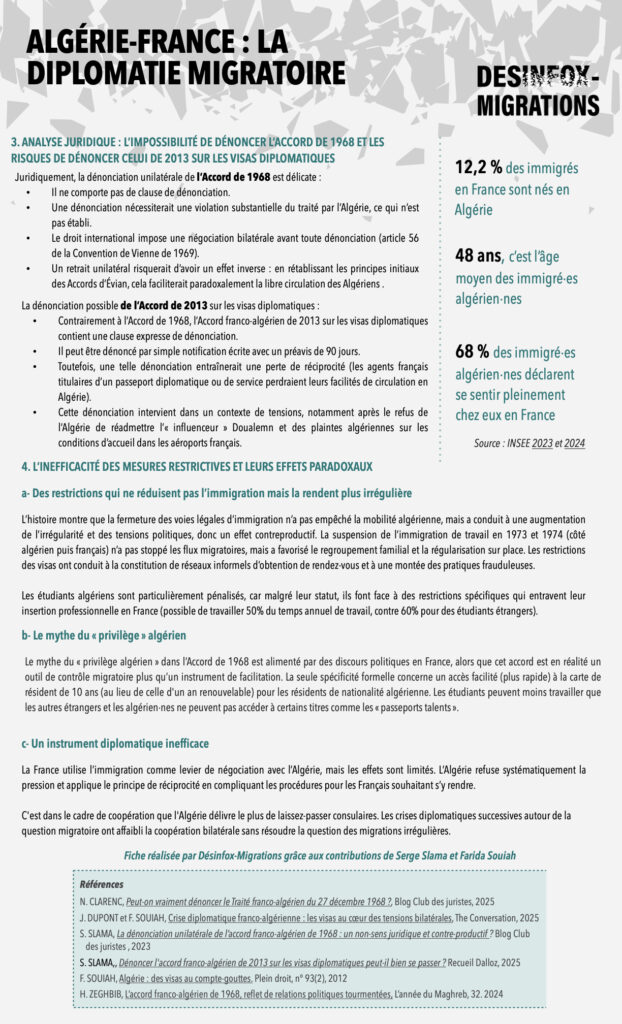
3. ANALYSE JURIDIQUE : L’IMPOSSIBILITÉ DE DÉNONCER L’ACCORD DE 1968 ET LES RISQUES DE DÉNONCER CELUI DE 2013 SUR LES VISAS DIPLOMATIQUES
Juridiquement, la dénonciation unilatérale de l’Accord de 1968 est délicate :
• Il ne comporte pas de clause de dénonciation.
• Une dénonciation nécessiterait une violation substantielle du traité par l’Algérie, ce qui n’est pas établi.
• Le droit international impose une négociation bilatérale avant toute dénonciation (article 56 de la Convention de Vienne de 1969).
• Un retrait unilatéral risquerait d’avoir un effet inverse : en rétablissant les principes initiaux des Accords d’Évian, cela faciliterait paradoxalement la libre circulation des Algériens .
La dénonciation possible de l’Accord de 2013 sur les visas diplomatiques :
• Contrairement à l’Accord de 1968, l’Accord franco-algérien de 2013 sur les visas diplomatiques contient une clause expresse de dénonciation.
• Il peut être dénoncé par simple notification écrite avec un préavis de 90 jours.
• Toutefois, une telle dénonciation entraînerait une perte de réciprocité (les agents français titulaires d’un passeport diplomatique ou de service perdraient leurs facilités de circulation en Algérie).
• Cette dénonciation intervient dans un contexte de tensions, notamment après le refus de l’Algérie de réadmettre l’« influenceur » Doualemn et des plaintes algériennes sur les conditions d’accueil dans les aéroports français.
4. L’INEFFICACITÉ DES MESURES RESTRICTIVES ET LEURS EFFETS PARADOXAUX
a- Des restrictions qui ne réduisent pas l’immigration mais la rendent plus irrégulière
L’histoire montre que la fermeture des voies légales d’immigration n’a pas empêché la mobilité algérienne, mais a conduit à une augmentation de l’irrégularité et des tensions politiques, donc un effet contreproductif. La suspension de l’immigration de travail en 1973 et 1974 (côté algérien puis français) n’a pas stoppé les flux migratoires, mais a favorisé le regroupement familial et la régularisation sur place. Les restrictions des visas ont conduit à la constitution de réseaux informels d’obtention de rendez-vous et à une montée des pratiques frauduleuses.
Les étudiants algériens sont particulièrement pénalisés, car malgré leur statut, ils font face à des restrictions spécifiques qui entravent leur insertion professionnelle en France (possible de travailler 50% du temps annuel de travail, contre 60% pour des étudiants étrangers).
b- Le mythe du « privilège » algérien
Le mythe du « privilège algérien » dans l’Accord de 1968 est alimenté par des discours politiques en France, alors que cet accord est en réalité un outil de contrôle migratoire plus qu’un instrument de facilitation. La seule spécificité formelle concerne un accès facilité (plus rapide) à la carte de résident de 10 ans (au lieu de celle d’un an renouvelable) pour les résidents de nationalité algérienne. Les étudiants peuvent moins travailler que les autres étrangers et les algérien·nes ne peuvent pas accéder à certains titres comme les « passeports talents ».
c- Un instrument diplomatique inefficace
La France utilise l’immigration comme levier de négociation avec l’Algérie, mais les effets sont limités. L’Algérie refuse systématiquement la pression et applique le principe de réciprocité en compliquant les procédures pour les Français souhaitant s’y rendre.
C’est dans le cadre de coopération que l’Algérie délivre le plus de laissez-passer consulaires. Les crises diplomatiques successives autour de la question migratoire ont affaibli la coopération bilatérale sans résoudre la question des migrations irrégulières.
Références
N. CLARENC, Peut-on vraiment dénoncer le Traité franco-algérien du 27 décembre 1968 ?, Blog Club des juristes, 2025
J. DUPONT et F. SOUIAH, Crise diplomatique franco-algérienne : les visas au cœur des tensions bilatérales, The Conversation, 2025
S. SLAMA, La dénonciation unilatérale de l’accord franco-algérien de 1968 : un non-sens juridique et contre-productif ? Blog Club des juristes , 2023
S. SLAMA, Dénoncer l’accord franco-algérien de 2013 sur les visas diplomatiques peut-il bien se passer ? Recueil Dalloz, 2025
F. SOUIAH, Algérie : des visas au compte-gouttes. Plein droit, n° 93(2), 2012
H. ZEGHBIB, L’accord franco-algérien de 1968, reflet de relations politiques tourmentées, L’année du Maghreb, 32. 2024


